Musiques spectrales.
Grand Angle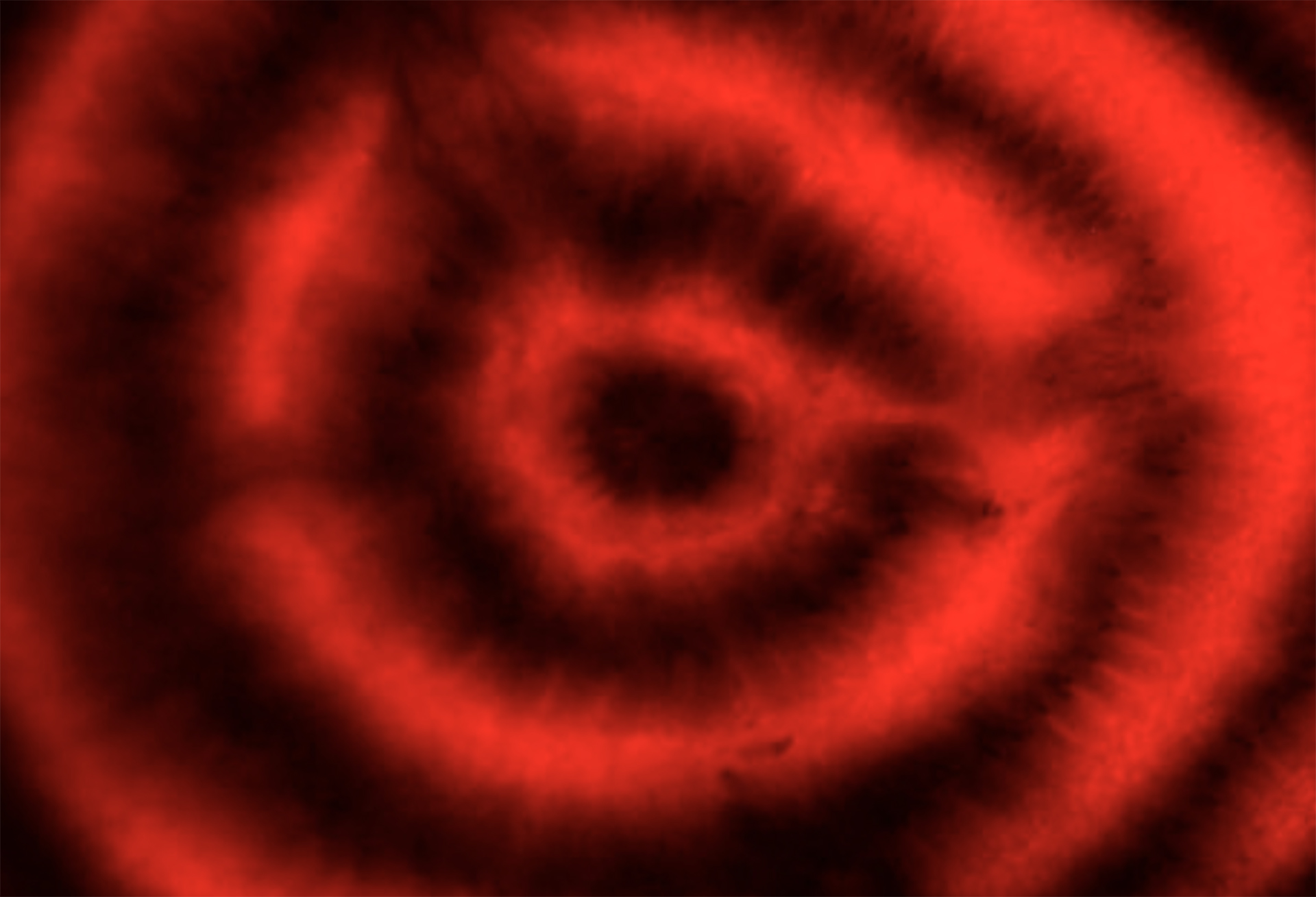
« Vous avez dit spectral ? » interrogeait un article rédigé par Gérard Grisey en 1998. La question pourrait bien trahir plus globalement l’embarras qui accompagne toute nomination, toute « étiquette », laquelle, si justifiée soit-elle, court le risque d’opacifier ce qu’elle recouvre. Dans le cas de la musique « spectrale », la précision du terme n’en rend pas le décodage aisé au profane. On pourrait croire que cette « musique de spectre » fait tourner les tables ou revenir les disparus. Elle explore en réalité un sens technique du terme de « spectre » et se déploie dans des régions assurément plus rationnelles.
Seuls les faits – les rencontres humaines – peuvent rendre à ce courant sa nécessité historique. Au début des années soixante-dix, plusieurs jeunes compositeurs français se réunissent autour de l’ensemble Itinéraire : Hugues Dufourt, Gérard Grisey, Michaël Levinas, Tristan Murail, Roger Tessier. Leur point commun : une certaine volonté de rompre avec l’hégémonie sérielle et une certaine influence de la musique électronique, sinon dans ses sonorités, du moins dans l’approche nouvelle du son ouverte par celle-ci. De fait, l’outil informatique fournit à l’aventure son point de départ, l’expérience réalisée par Gérard Grisey avec Périodes (1974) : tout d’abord l’analyse des composantes harmoniques d’un son donné (un mi de trombone), puis la redistribution de ces harmoniques sur les différentes voix d’un ensemble instrumental. Cette technique que Grisey nomme « synthèse instrumentale » sera déterminante à plus d’un titre. Certes peu nouvelle (outre-Altantique, des compositeurs comme James Tenney et La Monte Young ont déjà pu défricher ce terrain), elle donnera toutefois, à ce moment et ce lieu de l’histoire, l’impulsion nécessaire pour offrir, face à la musique sérielle, une alternative qui se situe sur le même plan, partant d’un procédé technique pour aller vers la définition d’un paradigme esthétique.
 Ce procédé cristallise en effet dans la conception du matériau de l’écriture un ensemble de déplacements. Un grossissement, tout d’abord, un mouvement de fouille à l’intérieur même de la matière. Ce qui, encore dans la musique sérielle, se donne au compositeur sous la forme de « notes » à combiner et de « paramètres » à configurer, se présente désormais comme bloc (le « son ») à travailler de l’intérieur jusqu’à son atome même, le partiel de fréquence – Partiels donnera son titre littéral à une pièce de Grisey. La musique spectrale « dé-compose » avant même de composer. Se mouvant dans l’infiniment petit du son, elle organise des « processus » plutôt que des développements, mettant au jour le continu plutôt que le disparate. Jouant des seuils de perception, elle explore ces régions où l’harmonie et le timbre se recouvrent, elle se déploie en trames sonores que Grisey qualifie d’objets « hybrides » : « ni des accords ni des timbres, mais un croisement entre les deux ».
Ce procédé cristallise en effet dans la conception du matériau de l’écriture un ensemble de déplacements. Un grossissement, tout d’abord, un mouvement de fouille à l’intérieur même de la matière. Ce qui, encore dans la musique sérielle, se donne au compositeur sous la forme de « notes » à combiner et de « paramètres » à configurer, se présente désormais comme bloc (le « son ») à travailler de l’intérieur jusqu’à son atome même, le partiel de fréquence – Partiels donnera son titre littéral à une pièce de Grisey. La musique spectrale « dé-compose » avant même de composer. Se mouvant dans l’infiniment petit du son, elle organise des « processus » plutôt que des développements, mettant au jour le continu plutôt que le disparate. Jouant des seuils de perception, elle explore ces régions où l’harmonie et le timbre se recouvrent, elle se déploie en trames sonores que Grisey qualifie d’objets « hybrides » : « ni des accords ni des timbres, mais un croisement entre les deux ».
Changement d’échelles
Puis vient le réajustement des techniques d’écriture (la transposition des résultats de l’analyse). Lorsqu’on fouille à l’intérieur du son, fût-ce un son aussi familier que celui d’un trombone, on y découvre des données qui résistent aux conceptions établies, et notamment la division dite tempérée de l’octave en douze demi-tons. Le recours aux micro-intervalles devient alors une nécessité ; il ouvre à un univers harmonique infiniment riche qui ne distord les hauteurs que pour les ajuster à des phénomènes physiques réels – d’une certaine façon, donc, familiers à l’oreille. D’où l’essentielle « transparence » de la musique spectrale, évoquée par Dufourt dans son manifeste « Musique spectrale » rédigé en 1979. Il n’est nulle question de rupture, et nous sommes loin des avant-gardes. Les antécédents existent et sont reconnus comme tels : une filiation française aura, depuis Rameau au XVIIIe siècle jusqu’aux images debussystes et aux couleurs de Messiaen, travaillé à valoriser l’harmonie, à la défonctionnaliser et la prendre pour elle-même comme pur affect musical.
Dans sa volonté d’éclater la note et de libérer la dynamique sonore, Varèse fut également un pré-spectral. Stockhausen et Ligeti ont quant à eux influencé les compositeurs spectraux par leur idée du continuum sonore, qui se donne déjà comme une « plastique sonore de masses et de tons » (Dufourt). Mais de cette tradition, la musique spectrale entend toutefois se distinguer par son traitement spécifique du temps – une conséquence du procédé de synthèse instrumentale lui-même, liée au changement d’échelle de l’objet sonore. Le grossissement qui, dans la synthèse instrumentale, transpose les phénomènes microphoniques dans l’ordre du macrophonique, s’accompagne d’une dilatation du temps. Jusqu’alors conçue dans la temporalité du langage humain, ou encore dans celle d’un surgissement incessant, la musique se calque sur d’autres échelles de durées : le temps des phases de sommeil ou du chant des baleines.
Réintroduire une directionnalité
La question du temps laisse également transparaître certaines disparités au sein du courant. Après quelques partitions imagées, processuelles et lentes (dont les Treize couleurs du soleil couchant), Tristan Murail s’est de son côté dirigé vers une écriture dramatique, marquée par de rapides mouvements de tension / détente et des contrastes de couleurs très marqués. L’enjeu touche au langage même : il s’agit de réattribuer à l’harmonie la force directionnelle qu’elle a perdue depuis l’abandon de la tonalité. Le compositeur entend « réintroduire au sein des phénomènes sonores des systèmes de hiérarchie, d’aimantation, de directionnalité permettant de créer une rhétorique musicale sur des bases neuves ». L’ordinateur devient alors un indispensable assistant « pour modéliser, pour estimer, pour évaluer toutes ces successions et superpositions d’harmonies ou de timbres si riches » . Dans L’esprit des dunes (1994), l’analyse spectrale prend véritablement en compte la donnée temporelle : le compositeur y recourt à la technique alors nouvelle du « suivi de partiels » : « on décompose le son en partiels, comme dans l’analyse classique, mais on suit leur évolution dans le temps ».
Que le courant spectral ait fini par s’auto-dissoudre sans toutefois que n’intervienne de véritable dissension ne saurait étonner. L’aventure était humaine : née de rencontres, elle s’est épuisée lorsque les personnalités se sont affirmées et ont pris des chemins différents, voire opposés. Michaël Levinas justifie sa prise de distance avec l’esthétique spectrale en évoquant ce qui n’y trouvait pas de place : le « concept d’accident, de révélation de l’idée musicale, d’au-delà du système, de caprice du musical, de rencontre avec la textualité ». À cela s’ajoute un facteur historique : le déclin de l’esprit de système et de l’énergie collective des « groupes ». Les techniques et la pensée demeurent, mais se diluent. Désormais largement employée, la synthèse instrumentale a pu s’hybrider avec les tentations « bruitistes » des années 1990-2000, depuis les timbres voilés de Salvatore Sciarrino jusqu’aux bad trips psychédéliques de Fausto Romitelli.
Une perspective plus globale est alors ouverte. Si l’on remonte en amont dans l’histoire, la musique spectrale rencontre non seulement des précurseurs, mais également des points de dissidence. Deux figures majeures autant que marginales, Giacinto Scelsi et Morton Feldman rejoignent l’esthétique spectrale par leur souci d’appréhender le son de l’intérieur, mais s’en éloignent par leur refus de tout système et le caractère radicalement empirique de leurs démarches respectives.
C’est à la villa Médicis à Rome, où séjournèrent en 1974 les jeunes Grisey et Murail, que ces derniers rencontrèrent l’œuvre de Scelsi, déterminante pour le futur courant spectral. Une personnalité forte, une musique fascinante, mais un héritage difficile. La rupture avec l’ordre établi prend chez ce compositeur d’ascendance noble une allure frontale : au tournant des années cinquante, il détruit presque toute sa production antérieure, d’inspiration sérielle, traverse une grave crise personnelle et trouve refuge dans une spiritualité d’origine hindoue. On raconte que lors de ses séjours en hôpital psychiatrique, il ne joue plus au piano que sur un seul la bémol. Les Quattro pezzi su una nota sola (1959), chacun écrit sur une seule note, octaviée et variée en micro-intervalles, portent la trace de ce geste réductionniste, opérateur non seulement d’une décomposition pré-spectrale, mais plus problématiquement d’une dépersonnalisation radicale de l’écriture. Inapte à la concentration qu’exige l’écriture sur partition, Scelsi recourt à l’ondioline pour composer, instrument électronique qui lui permet un contact immédiat avec le son, lui offre la possibilité de le moduler in vivo en micro-intervalles. Par ce primat du spontané, le compositeur se retire : il n’est plus qu’un intermédiaire, un « facteur », selon ses propres termes, livrant au monde des messages issus d’une réalité transcendantale. À travers l’œuvre et le corps du musicien, c’est le son lui-même qui « parle ».
C’est à un semblable geste de retrait que conduisent les tentatives de l’Américain Morton Feldman pour pénétrer l’intérieur du son, mais sans recours à quelque mystique. « Seul véritable minimaliste » selon Grisey, Feldman s’est efforcé de concevoir sa musique avec les outils conceptuels du plasticien : en termes de plans, d’espace, de projection, de surfaces. Le cycle des Durations (1960-1961) propose ainsi une composition proche du mobile de Calder, qui individualise et rend autonome chaque voix instrumentale. Mais le geste de « projection des sons » se fait ici avec une immense retenue, tendue vers le silence sans jamais toutefois le viser pour lui-même : l’abondance des nuances pianissimo, l’étirement extrême des durées (son second quatuor à cordes de 1985 ne dure pas moins de cinq heures et demie) et la valorisation des résonances, dans l’emploi du piano en particulier, caractérisent cette musique qui se donne d’elle-même, et qui est davantage posée que composée. Une musique sans violence. Douce sans être pour autant rassurante ou lénifiante. Neutre, peut-être, comme le sont ces objets minimaux sans qualités qui peuplent les partitions du compositeur (notes tenues, accords, micro-mélodies), objets simplement posés les uns à côté des autres, « juxta-posés ». Neutre comme l’est en définitive le son nu qui a renoncé à être « pur », mais qui, dans l’optique cagienne, se donne, tout plein à son mystère, comme ce qu’il est.
pour pénétrer l’intérieur du son, mais sans recours à quelque mystique. « Seul véritable minimaliste » selon Grisey, Feldman s’est efforcé de concevoir sa musique avec les outils conceptuels du plasticien : en termes de plans, d’espace, de projection, de surfaces. Le cycle des Durations (1960-1961) propose ainsi une composition proche du mobile de Calder, qui individualise et rend autonome chaque voix instrumentale. Mais le geste de « projection des sons » se fait ici avec une immense retenue, tendue vers le silence sans jamais toutefois le viser pour lui-même : l’abondance des nuances pianissimo, l’étirement extrême des durées (son second quatuor à cordes de 1985 ne dure pas moins de cinq heures et demie) et la valorisation des résonances, dans l’emploi du piano en particulier, caractérisent cette musique qui se donne d’elle-même, et qui est davantage posée que composée. Une musique sans violence. Douce sans être pour autant rassurante ou lénifiante. Neutre, peut-être, comme le sont ces objets minimaux sans qualités qui peuplent les partitions du compositeur (notes tenues, accords, micro-mélodies), objets simplement posés les uns à côté des autres, « juxta-posés ». Neutre comme l’est en définitive le son nu qui a renoncé à être « pur », mais qui, dans l’optique cagienne, se donne, tout plein à son mystère, comme ce qu’il est.
À découvrir également :
Extrait d’Accents n° 41 – avril-août 2010
Photos © Elisabeth Schneider
Partager