György Kurtág : Naissance d’un musicien.
Portrait À l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, l’Ensemble intercontemporain rendra hommage à l’un des plus grands compositeurs de notre temps, lors de deux concerts à la Philharmonie de Paris, dont un premier rendez-vous en format chambriste le 19 février.
À l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, l’Ensemble intercontemporain rendra hommage à l’un des plus grands compositeurs de notre temps, lors de deux concerts à la Philharmonie de Paris, dont un premier rendez-vous en format chambriste le 19 février.
L’occasion de redécouvrir ce texte du début des années 1980 retraçant la jeunesse musicale de Kurtág : de la révélation fondatrice de la Symphonie inachevée de Schubert à ses premiers pas au piano et à la composition, nourris par la complicité avec sa mère et l’influence décisive de Bartók, Schubert ou Penderecki.
Je devais avoir onze ou douze ans lorsque se produisit ce à quoi je dois d’être devenu musicien. La radio diffusait la Symphonie inachevée de Schubert, et lorsque mes parents me dirent le titre de ce que nous étions en train d’écouter, je découvris avec stupeur que les adultes étaient à même de reconnaître la musique classique. Plus tard, alors que j’étais seul à la maison et que j’écoutais de la musique à la radio, je me rendis compte qu’il s’agissait de nouveau de l’Inachevée. Je demandai à mes parents de m’acheter la partition, ce qu’ils firent, et j’appris la transcription pour piano de la symphonie. C’est ce qui détermina le fait que la musique allait devenir extrêmement importante dans ma vie.
Lorsque j’avais entre cinq et sept ans, j’apprenais le piano et j’aimais la musique classique. À l’âge de sept ans, je cessai d’apprendre et je perdis tout intérêt pour la musique. Je bâclais mes exercices de piano et n’en faisais guère que cinq ou dix minutes par semaine, parce que mon propre jeu ne me permettait d’accéder à aucune impression profonde. Ce sont les danses, le tango, la valse et les marches qui me ramenèrent à la musique. J’avais une dizaine d’années lorsque je commençai à fréquenter un cours de danse ; puis nous sommes allés passer les vacances en famille à Baile Herculane : je dansais tous les soirs avec ma mère au « Kursalon ».

György Kurtág enfant avec sa mère, 1930.
La danse constituait donc l’un des moyens de séduction utilisés par ma mère durant l’été (photo ci-contre). En hiver, c’était le piano à quatre mains. Nous jouions des transcriptions brèves et rudimentaires de différents passages d’opéras. C’était bon de danser avec elle (pour moi, chaque tango, chaque valse avait son caractère à part), et c’était aussi bon de jouer à quatre mains ensemble. Et voilà qu’un jour, nous nous sommes lancés sans préparation aucune dans le premier mouvement de l’Héroïque. L’entreprise dépassait largement mes aptitudes (et peut-être même nos aptitudes à tous les deux), mais nous avons lu entièrement la symphonie, puis nous sommes passés à la Première et à la Cinquième. Mais ma mère n’a jamais voulu jouer la marche funèbre de l’Héroïque. À l’époque, j’y voyais de la superstition pure, mais il est possible que cela ait été en fait une prémonition, car elle est morte à l’âge de quarante ans seulement. Entre cinq et sept ans, j’ai même composé — deux petites pièces pour piano, je crois — et plus tard, lorsque la symphonie de Schubert m’a si fortement impressionné, cela eut aussi pour effet de me ramener à la composition. Je voulais écrire une symphonie juive en mi mineur, qui aurait eu pour titre Éternel espoir. Mais en ce temps-là, j’écrivis aussi beaucoup d’autres choses…
Des œuvres écrites par d’autres produisirent sur moi une impression profonde, mais il était généralement fort rare qu’une composition me fasse de l’effet à la première audition. J’avais par exemple lu beaucoup de choses sur la Neuvième, mais je fus très déçu en l’entendant pour la première fois, car les impressions littéraires que j’en avais retirées m’avaient orienté dans une direction toute différente. Elles m’avaient fait imaginer une Neuvième dont la réalité était si éloignée que je me sentis incapable de m’y habituer.
 La Cantate profane et la Musique pour cordes, percussions et célesta, de Bartók (photo ci-contre) produisirent quant à elles sur moi un effet foudroyant ; mais cela ne veut pas dire pour autant que leur influence se soit faite sentir dans mes propres compositions. Je fus influencé avec la même force par le Concerto pour violon de Bartók, que j’entendis pendant la guerre à la BBC. […] Plus tard, cependant, deux ou trois mois après que je fus arrivé à Budapest, ce même Concerto devait produire sur moi l’une des impressions les plus profondes qu’il m’ait été données de vivre. J’assistai alors à toutes les répétitions de Doráti et de Menuhin, puis j’appris la partie de piano de l’accompagnement (des années durant, je fus sans doute le seul à la connaître à fond), et je la jouai pendant plusieurs années avec Ede Zathureczky. Et toutes les fois que quelqu’un d’autre apprenait la partie de violon, j’étais là pour l’accompagner pendant les répétitions.
La Cantate profane et la Musique pour cordes, percussions et célesta, de Bartók (photo ci-contre) produisirent quant à elles sur moi un effet foudroyant ; mais cela ne veut pas dire pour autant que leur influence se soit faite sentir dans mes propres compositions. Je fus influencé avec la même force par le Concerto pour violon de Bartók, que j’entendis pendant la guerre à la BBC. […] Plus tard, cependant, deux ou trois mois après que je fus arrivé à Budapest, ce même Concerto devait produire sur moi l’une des impressions les plus profondes qu’il m’ait été données de vivre. J’assistai alors à toutes les répétitions de Doráti et de Menuhin, puis j’appris la partie de piano de l’accompagnement (des années durant, je fus sans doute le seul à la connaître à fond), et je la jouai pendant plusieurs années avec Ede Zathureczky. Et toutes les fois que quelqu’un d’autre apprenait la partie de violon, j’étais là pour l’accompagner pendant les répétitions.
Cette œuvre devait influer très directement sur la composition de mon Concerto pour alto. J’y ai même fait des emprunts, quoique l’influence du Concerto pour orchestre et de différentes autres compositions y soit plus sensible. Toujours est-il que la familiarisation, la connaissance acquise petit à petit, a toujours été plus importante pour moi que la première rencontre avec une œuvre. Généralement parlant, il ne m’est arrivé que rarement d’entendre quelque chose et de sentir immédiatement son importance.
En vérité, […] je n’aimais pas Bartók. Il était pour ainsi dire trop horriblement bon… […] La première fois que j’entendis Le Château de Barbe-Bleue, par exemple, je trouvai cela positivement laid. Il n’empêche que l’œuvre me fit de l’effet. Sans compter que son charme se trouvait rehaussé par le fait qu’elle se heurta aux résistances de mon entourage. En fait, c’est en dépassant mes goûts et mon savoir personnels que j’ai découvert la saveur de la musique de Bartók.
Il est une autre musique qui m’a profondément influencé : le Thrène « À la mémoire des victimes d’Hiroshima » de Penderecki ; un passage des « Dits » de Bornemisza, « La mort de l’homme… » (troisième partie), lui fait pendant. Le souvenir d’« À la mémoire des victimes d’Hiroshima » a nettement influé sur la structure de la partie de piano de ce passage… J’ai aussi été influencé par Webern, non pas en entendant ses œuvres, mais en les étudiant, en « interrogeant » les petits détails. Dans le cas de Bartók également, ma véritable rencontre avec sa musique s’est faite en m’exerçant à la jouer… La première de ses œuvres qui me marqua, lorsque j’avais environ quatorze ans et que je me destinais déjà à la carrière musicale à Timisoara, fut la deuxième Bagatelle. Je n’y compris pas grand-chose. La suivante fut la Chanson des Neuf petites pièces pour piano de 1926. […]
Ma première composition, que j’assume d’ailleurs de plus en plus, fut une Suite pour piano. Je ne sais plus exactement à quel âge je l’écrivis — seize ou dix-sept ans. Le premier volet, « On dirait quelqu’un qui vient » (Mintha valki jönne), est une réponse à un Lied sur un poème d’Ady écrit par Max Eisikovits, qui était mon professeur de composition. Son vécu profond, le fait d’attendre quelqu’un et de ne voir arriver personne, m’était douloureusement familier, et c’est ce qui a donné la première partie de ma Suite. […]
Curieusement, il m’est arrivé quelquefois encore, par la suite, de donner un programme à la première partie d’une composition. Tel a par exemple été le cas pour mon Quatuor à cordes op. 1. Je ne pourrais pas vous dire si j’y ai cherché et trouvé le programme en question après coup, ou bien si j’y pensais effectivement en l’écrivant. Je vivais alors à Paris, et je traversais une crise qui me mettait dans l’incapacité complète de composer : 1956 a vraiment été pour moi l’écroulement de tout un monde. Non seulement le monde extérieur, mais aussi mon univers intérieur. De nombreux problèmes d’ordre moral se posaient en rapport avec mon travail sous la direction de Marianne Stein, toute mon attitude humaine devenait problématique. Je touchai complètement le fond. Auparavant, j’avais rejeté sur les autres un tas de responsabilités, et il a fallu que je réalise pratiquement du jour au lendemain que c’était moi-même, mon propre caractère, qui m’avaient déçu. Je ne suis capable de composer que lorsque je m’entends pour ainsi dire bien avec moi-même, lorsque je m’accepte tel que je suis — lorsque je parviens en quelque sorte à une identité de vues avec moi-même. Or, à Paris, je réalisai jusqu’au désespoir que rien de ce que j’avais cru constituer le monde n’était vrai, et que je ne pouvais me raccrocher à rien dans la réalité. […]

György Kurtág, 1955
Cette année passée à Paris et le travail auprès de Marianne Stein ont pratiquement coupé ma vie en deux. Je perdis alors vingt kilos. […] Et puis je commençai à faire de la gymnastique. J’avais toujours été particulièrement peu doué pour cela. J’avais commencé par imiter les exercices que faisait ma mère (lorsque j’étais à Paris, je l’avais perdue depuis plus de dix ans), mais par la suite, je les perfectionnai à ma manière. Mes mouvements étaient terriblement anguleux, c’était presque une pantomime.
J’essayai alors de modifier aussi mon écriture et de la rendre plus anguleuse, plus crispée.
L’étape suivante fut la construction de formes, également anguleuses, avec des allumettes. Je me créai tout un univers de symboles. Je me sentais moi-même dans un état comparable à celui d’un ver de terre, avec des caractéristiques humaines réduites à leur plus simple expression.
Les formes construites avec des allumettes, des moutons de poussière (je ne faisais pas le ménage tous les jours) et des mégots noircis (car en plus, je fumais) me représentaient. J’intitulai ma composition en allumettes « Le cancrelat à la recherche de la voie conduisant vers la lumière » (j’avais posé à l’extrémité de la composition d’allumettes une forme lumineuse en aluminium). Tel devait être aussi le programme du premier mouvement de mon quatuor. La lumière y est symbolisée par l’accord de flageolet, après toute cette saleté… J’ai failli écrire en exergue de ce mouvement deux lignes de Tudor Arghezi : Din mucegaiuri, bube si noroi. Iscat-am frumuseti si preturi noi [J’ai fait naître des beautés et des valeurs neuves de la moisissure, des plaies purulentes et de la boue]. Mais elles étaient déjà présentes au fond de moi lorsque je construisis mes compositions en allumettes…
Cette citation est liée à quelqu’un, Felician Brînzeu, qui était professeur au collège de Lugoj. Dans ma vie, c’est lui qui fut le maître, le pédagogue par excellence.
En musique, c’est Magda Kardos qui devait me marquer ainsi d’une empreinte indélébile. Lorsque j’étais en seconde année de collège, Brînzeu parvint à faire apprendre la grammaire roumaine en l’espace de trois mois à une classe d’une cinquantaine de gosses, en grande partie des petits paysans, sans mettre une seule note, en parlant avec nous du programme tout le temps, au point que cela en devenait presque un jeu de société. Nous nous amusions formidablement, et il m’a fait comprendre pour le restant de mes jours ce qu’est la structure d’une langue…
En dessin, j’étais nul et j’ai échoué dans cette matière à l’examen. Je n’ai jamais été doué pour cela et aujourd’hui encore, je suis incapable de dessiner même les objets les plus simples. Mais durant l’année que je passai à Paris (et à la fin de la période de paralysie créatrice qui précéda Jeux (photo ci-contre), autrement dit un an environ avant leur 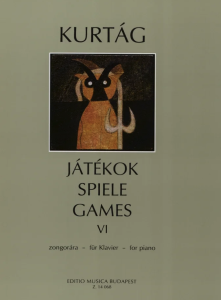 composition), je passai des mois entiers à dessiner, et uniquement cela, ou plutôt à laisser des signes sur le papier.
composition), je passai des mois entiers à dessiner, et uniquement cela, ou plutôt à laisser des signes sur le papier.
À Paris, je commençai par dessiner avec mes formes en allumettes. Ma chambre était pleine d’allumettes, et il fallait que je les détruise à chaque fois que je voulais faire le ménage. J’essayai donc, pour sauvegarder ces compositions, de les dessiner. Mais bien entendu, cela ne donna que des résultats absurdes. Puis je dessinai quelque chose — il y avait des étoiles sur les bords, et au milieu quelque chose de tordu en vrille. J’ai conservé le dessin, je l’ai encore. C’est cela que j’ai essayé de traduire en musique dans ma Pièce pour piano n° 7.
[…] J’avais, enfant, beaucoup plus d’oreille qu’aujourd’hui. J’étais capable de restituer vocalement n’importe quelle musique, n’importe quel bruit extérieur. Une fois, je ne sais plus exactement quand, à l’époque où ma voix mua ou plus tôt déjà, alors que je chantais dans les chœurs, je me fis attraper ; on me dit que je dérangeais les autres choristes. Depuis, peut-être à cause de cela, je n’ai plus l’oreille absolue pour le chant. Même pour les autres sons, mon ouïe s’est plutôt détériorée… J’ai d’ailleurs l’impression que ce n’est pas forcément avec les oreilles que j’entends et avec les yeux que je vois. À l’époque où j’étais collégien et où mes facultés s’éveillaient, j’ai lu pendant la guerre, dans l’Histoire de l’art de Lützeller, que l’architecture est en fait une impression spatiale, quelque chose qui vous entoure. Comme la musique, qui est aussi présente autour de vous.
J’ai retrouvé cette impression dans mes rencontres avec les cathédrales, par exemple à Reims ou à Chartres. Celle de Chartres, par exemple, est de façon extraordinaire à l’échelle humaine, elle a juste les dimensions que l’homme est en mesure d’embrasser du regard, et j’y ai eu l’impression de sentir l’espace avec ma peau, avec mon dos, lorsque je ne regardais pas… Pour moi, il en va fréquemment de même pour la musique. Elle passe d’une façon mystérieuse d’une sensibilité à l’autre, j’entends les choses sans les entendre…
Propos recueillis (1982-1985) par Bálint András Varga
> Deux concerts à la Philharmonie de Paris pour célébrer le centenaire de la naissance de György Kurtág : Ascendances le 19 février et Troussova, le 5 juin
écouter un extrait de Stele de György Kurtág
écouter un extrait de Jelek de György Kurtág (Odile Auboin, alto)
Texte extrait de György Kurtág. Entretiens, textes, écrits sur son œuvre. Éditions Contrechamps, Genève, 1995, p. 11-17
Photos (de haut en bas) : source fidelio.hu / © Budapest Music Center/ © Archives Bartók / MTI Fotó-Mandarchív : Zinner Erzsébet
Share